Dotations locales : une instruction ministérielle publiée le 5 juin 2024 vient préciser les priorités d’affectation et les modalités de gestion pour 2024
L’instruction concerne la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), la dotation politique de la ville (DPV) ainsi que le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT).

Les priorités d’affectation définies par l’instruction sont :
« L’accélération et la territorialisation de la transition écologique »
« au moins 30% des crédits de la DSIL, 25% de la DSID 20% de la DETR et 15% du FNADT devront être attribués à des projets favorables à l’environnement au sens du budget vert. »

Seront en particulier visés les projets d’investissements : de « rénovation énergétique des bâtiments publics », les projets de « rénovation thermique du bâti scolaire », les « projets contribuant à accroître la résilience des infrastructures face aux risques naturels (bâtiments, infrastructures de transports, réseaux d’eau) », « le développement des mobilités durables », « les projets destinés à adapter l’espace urbain » face au changement climatique.
Il est toutefois à noter que l’installation de panneaux photovoltaïques ne sera plus financée à travers ces dotations.
- « L’accessibilité des bâtiments publics »
- « La construction et rénovation des équipements sportifs » en prévision des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024
- « La rénovation et mise en sécurité du patrimoine culturel »
En matière de temporalité, la circulaire précise que « 80% des subventions devront être notifiées avant la fin du premier semestre 2024; l’ensemble des autorisations d’engagement déléguées devront avoir été consommées avant le 31 décembre 2024. »
Albert, la nouvelle IA, quelle utilisation et quels avantages pour les collectivités territoriales ?
Le lancement d’Albert, une intelligence artificielle développée par la société française Sinay, spécialisée dans l’analyse de données et les solutions numériques pour les territoires, a été annoncée par le Premier Ministre le 23 avril 2024, lors de son déplacement à Sceau.
En quoi consiste réellement cette IA et quel intérêt présente-t-elle pour les collectivités territoriale ?
Une plateforme conçue pour faciliter la gestion au sein des collectivités territoriales
Conçue pour optimiser les services publics, la plateforme d’IA dénommée Albert intègre des technologies avancées présentant plusieurs fonctionnalités :
- Collecte de données provenant de diverses sources (bases de données municipales, réseaux sociaux par exemple)
- Analyse et traitement via l’utilisation des algorithmes avancés de traitement du langage naturel (NLP), d’apprentissage automatique (machine learning) et de deep learning pour analyser les données collectées
- Prédiction et anticipation permettant par exemple de prédire des événements futurs, comme des pics de demande pour certains services municipaux, ou des incidents potentiels comme des pannes d’infrastructure.
- Interactions avec les utilisateurs pour poser des questions, signaler des problèmes, ou obtenir des informations personnalisées.
- Recommandations établies sur la base des données collectées.
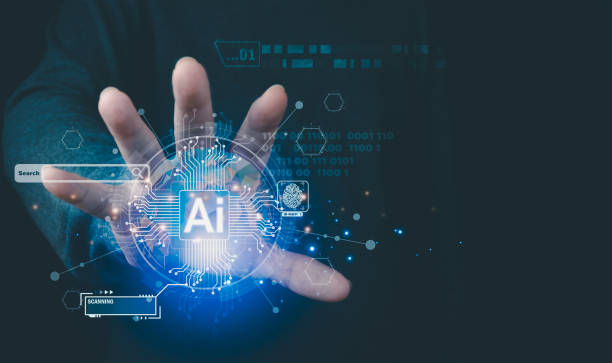
Des nouvelles technologies accessibles aux collectivités :
Ces fonctionnalités visent une facilitation de la gestion au sein des collectivités territoriales:
- L’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation de tâches répétitives
- L’optimisation en matière de gestion des ressources par exemple pour la gestion des déchets, la maintenance des infrastructures
- La facilitation de la communication avec les citoyens avec des interfaces interactive
- L’aide de à la prise de décision auprès des responsables municipaux
- La réactivité et l’amélioration dans l’anticipation des besoins, grâce à la détection des anomalies et la prévision des évènements futurs
- La favorisation de l’innovation et de la modernisation au sein des collectivités territoriales
Des écueils à prendre en compte et à éviter :
Cependant, ces objectifs d’optimisation et de facilitation de la gestion présentent également quelques écueils et risques à prendre en compte, tels que :
- La sécurité des données : la collecte des données peut exposer les collectivités à des risques de piratage et de violation de confidentialité. Aussi, il est crucial de garantir la protection des données personnels des citoyens, conformément aux réglementations telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
- Un autre risque : celui de la dépendance technologique qui peut s’avérer dangereuse en cas de dysfonctionnement de l’IA, ou en cas de compétences techniques inadapté des petites collectivités.
- L’impact social de l’IA peut s’avérer négatif du fait de l’automatisation de certaines tâches créant une réduction d’emplois. Par ailleurs, certains citoyens peuvent se montrer réticents face à ces nouvelles technologies du fait de leur complexité ou d’une crainte du caractère intrusif.
La reprise en charge par l’Etat de la rémunération des AESH
Pour ces raisons, le lancement d’Albert peut encore susciter des interrogations et des appréhensions justifiés pour les collectivités. Ce nouvel outil technologique peut s’avérer avantageux si l’utilisation est bien ciblée, préparée et encadrée.
À partir de la prochaine rentrée de septembre 2024, l’État reprendra en charge la rémunération des AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) pendant la pause de midi. La loi confirmant cette prise en charge par l’État a été publiée au Journal officiel du 28 mai 2024.
Zoom sur 2 dispositions de la Loi « Climat et Résilience » – 2021
(loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)
Le développement durable et la commande publique : lancement d’une consultation par la DAJ sur le projet de décret d’application de la loi portant diverses modifications du code de la commande publique.
Selon les dispositions de l’article 35 de la loi « Climat et résilience », le code de la commande publique se voit insérer un nouvelle article selon lequel « La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale »
Dans ce cadre la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) lance une consultation jusqu’au 27 janvier 2022, sur le projet de décret d’application de la loi Climat et Résiliences portant diverses modifications du code de la commande publique.
En effet, le projet de décret a pour objet de mettre en cohérence la partie règlementaire du code de la commande publique avec les dispositions de l’article 35 de la loi « qui impose aux autorités contractantes de prévoir un critère de sélection prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres et aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l’autorité concédante les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. L’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 21 août 2026, date limite d’entrée en vigueur prévue par la loi. »
En outre, ce projet apporte d’autres mesures ayant une incidence sur les pratiques des acteurs de la commande publique :
– l’extension de l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) : à compter du 1er janvier 2023 , abaissement du seuil d’application de l’obligation d’élaborer un SPASER de 100 millions d’euros à 50 millions d’euros d’achats annuels (ce qui concernerait environ 300 collectivités contre 130 aujourd’hui).
– l’adaptation du code de la commande publique pour le déploiement de l’interopérabilité des profils d’acheteurs : le projet de décret prévoit la mise en œuvre par l’Etat d’une plateforme d’interopérabilité des profils acheteurs ayant pour objectif de sécuriser la procédure de dépôt des candidatures et des offres sur des profils acheteur différents, notamment pour ce qui est de l’horodatage.
– la mise en œuvre de la convergence des données essentielles et des données du recensement économique des marchés publics : Le projet de décret prévoit que
« L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.
« Ces données essentielles portent sur :
« 1° La procédure de passation du marché ;
« 2° Le contenu du contrat ;
« 3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.
Lien vers la consultation : https://www.economie.gouv.fr/daj/consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-dapplication-de-la-loi-climat-et-resilience

Zéro artificialisation nette des sols : un report d’échéance demandé par l’AMF et Régions de France
C’est dans son article 192, que la loi « Climat et Résilience » vient introduire la « lutte contre l’artificialisation des sols » parmi les principes visés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, en l’associatiant à un objectif « d’absence d’artificialisation des sols nette à terme ».
La loi précise que ces objectifs doivent être poursuivis en recherchant l’équilibre entre:
« la maîtrise de l’étalement urbain,
le renouvellement urbain,
l’optimisation de la densité des espaces urbanisés,
la qualité urbaine,
la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville,
la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers,
[et] la renaturation des sols artificialisés ».
Cet objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols ou ZAN (zéro artificialisation des sols) est fixé au niveau national pour 2050. Pour y parvenir, la loi précise dans son article 191, que le rythme de l’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années «doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant » , soit une échéance au 22 février 2022 pour décliner les objectifs de division par deux de l’artificialisation des sols en dix ans dans les schémas de cohérence territoriale (Scot)
Cette échéance alerte les associations d’élus qui considèrent que de tels objectifs ne peuvent être atteints «dans la précipitation et sans méthode claire et partagée. »
« Ensemble, l’AMF et Régions de France estiment que la loi Climat et résilience du 22 août dernier impose des délais trop contraints aux communes, intercommunalités, comme aux régions, pour fixer dans les conférences régionales des Scot la déclinaison de l’objectif de réduction par deux de la consommation effective d’espaces naturels agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. »
Ces 2 associations d’élus demandent « le report d’un an minimum de la date limite de réunion de la Conférence des SCoT fixée au 22 février 2022 » ainsi que « l’allongement équivalent du délai d’intégration de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans leur SRADDET par les régions ». Elles demandent également « une clarification des éléments méthodologiques d’appréciation de la consommation d’espaces observée et de territorialisation des objectifs »